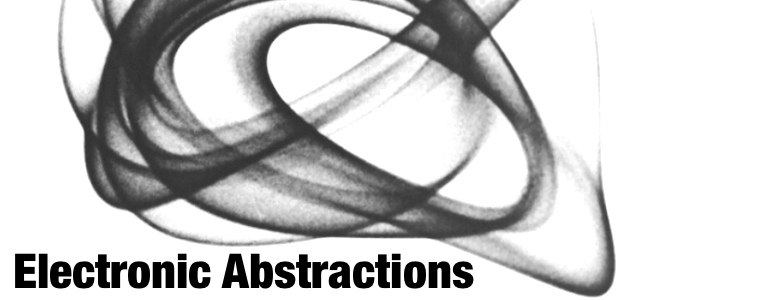mardi 15 octobre 2024
ROBOTS BORDEAUX 2024 - 18-19 oct. 2024
lundi 23 septembre 2024
Journée d'étude RE:24
RE:24
Journée d'étude organisée par
Joffrey Becker, Lilyana Petrova & Syd Reynal
Dans le cadre de la chaire Artss
Jeudi 17 oct. 2024
ENSEA- CURIUM
6 avenue du Ponceau
95000 Cergy
Inscription obligatoire sur :
https://forms.gle/eg8VQK7gThW3vNqX9
La journée d'étude RE:24 cherche à construire un dialogue interdisciplinaire autour de questions situées à l'interface de l'environnement, des sciences et des techniques, de la société et des représentations. Elle vise à explorer de nouvelles manières de faire et de produire des savoirs, en portant l'intérêt sur les rapports entre arts et science, sur la conception d'objets techniques sobres, soutenables, socialement et culturellement pertinents, mais aussi sur l'expérimentation de nouvelles modalités de l'écriture scientifique. L'ambition est d'engager des échanges autour de questions technologiques et épistémologiques à l’interface de disciplines issues autant des sciences et techniques de l’ingénieur que des sciences humaines et sociales.
Programme
9h-9h30 Accueil
9h30-10h15
Joffrey Becker
ETIS UMR8051 / CY Cergy Paris Université, ENSEA, CNRS
Épistémologies en reconfiguration
10h15-11h
Sophie Sakka
Grhapes EA7287 / INSHEA
Robotique et société
11h-11h45
Alexandre Pitti & Arnaud Blanchard
ETIS UMR8051 / CY Cergy Paris Université, ENSEA, CNRS
Les enjeux de la sobriété en robotique
12h-14h Pause
14h-14h45
Lilyana Petrova & Syd Reynal
ETIS UMR8051 / CY Cergy Paris Université, ENSEA, CNRS
Des performances-pirates en conférence pour reconfigurer la production des savoirs
14h45-15h30
Antoine Henry
Gériico ULR4073 / Université de Lille
Une approche par l’équité pour rééquilibrer les relations entre artistes et plateformes
15h30-16h Pause
16h-16h45
José Halloy
LIED UMR8236 / Université Paris Cité
Quelles places pour les robots dans les écosystèmes ?
16h45-17h Conclusion
lundi 1 février 2021
Jeunes robots et vieilles personnes : Prendre soin et nouvelles technologies en gérontologie
https://www.chroniquesociale.com
Les nouvelles technologies facilitent-elles autant les relations thérapeutiques qu'elles les contraignent ? Comment penser leur usage dans le respect de l'éthique ? Que nous disent les robots utilisés en gérontologie de notre regard sur les personnes à qui on les propose ? Existe-t-il des cyberaddictions chez les sujets âgés ? Les technologies du virtuel se révèlent-elles, pour les patients comme pour les équipes, de solides supports de prendre soin ou des leurres dangereux ? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles répond la première partie de cet ouvrage. Les nouvelles technologies sont à la mode. Mais des robots à la télémédecine en passant par les systèmes dits «intelligents» à domicile ou en institution, on en parle souvent plus pour les juger, les louer ou les condamner, que pour les questionner. Le présent livre souhaite d'abord enrichir notre réflexion sur ces nouvelles technologies par les regards que portent sur elles des personnes venues d'horizons professionnels et disciplinaires différents : écrivain, anthropologue, philosophe, psychanalyste, psychologue... Dans une seconde partie, il donne la parole à des professionnels - ergothérapeute, médecin coordonnateur, gériatre, psychiatre, psychologue... - qui confrontent cet ensemble de réflexions à leurs pratiques et usages des nouvelles technologies. Des expériences et des pratiques qui permettent notamment de mieux cerner comment des robots - ici Paro et Nao - sont utilisés et perçus par leurs usagers ; comment un technopôle peut aider les professionnels dans l'usage des différentes technologies (en particulier de sécurité et d'assistance) ; quels sont les apports d'une expérience de téléconsultation en gérontopsychiatrie ; quelles leçons peut-on tirer, grâce au point de vue d'une ergothérapeute, sur l'accompagnement à l'utilisation de différentes technologies proposées - ou imposées - à des patients...
lundi 8 avril 2019
Séminaire Francophone Interdisciplinaire d'Alzheimérologie
jeudi 6 février 2014
À propos des drones...
 |
| Article extrait de la revue Popular Science (Août 1930) |
En réalité, si l'usage des drones télé-opérés pose question, c'est surtout autour de leur autonomie que se cristallisent aujourd'hui les débats. Avec le développement de l'intelligence artificielle il est désormais envisageable de déployer des robots, seuls ou en essaims, dans le cadre d'opérations de surveillance ou de reconnaissance, ou encore d'impliquer directement des machines dans des zones de combat. La conception et l'emploi de telles machines, capables de prendre seules l'initiative d'un tir, repose en des termes encore inédits les questions relatives aux armes frappant sans discrimination [5]. Comment une machine peut-elle faire la différence entre un combattant et un non-combattant à l'endroit même ou un soldat humain n'y parvient pas toujours ? À qui imputer la responsabilité d'un crime de guerre si la machine seule a pris la décision d'ouvrir le feu ? À quelles conditions une telle machine pourrait-elle respecter des règles élémentaires de morale ? À l'heure où aucun mécanisme de responsabilité pénale ne peut être appliqué à ces robots, des chercheurs en intelligence artificielle, en robotique, en droit ou en sciences sociales ont souligné l'urgence d'ouvrir le débat. Regroupés pour certains au sein de l'International Commitee for Robot Arms Control en 2009, ils œuvrent pour une meilleure connaissance des risques associés au développement de l'autonomie des « robots tueurs » et plaident pour leur interdiction auprès des instances internationales [6].
Ces débats récents soulignent l'importance, pour les chercheurs et plus largement pour les membres de la société civile, de s'emparer des nombreuses questions morales et légales que soulèvent l'autonomie des machines de guerre.
Notes
[1] Percheron publie L'Aviation de Demain, Télémécanique, La direction des avions par TSF en 1921.
[2] Cet effacement des frontières suit de près le développement des technologies issues de la robotique. Fondées principalement sur un bouclage entre senseurs et actionneurs (selon la définition de l'agent idéal donnée par Stuart Russel et Peter Norvig) les technologies embarquées sur les robots militaires diffèrent à peine de celles des robots dits sociaux ou médicaux.
[3] Le Guardian du 17 septembre 2009 rapporte par exemple que des insurgés irakiens auraient intercepté les signaux vidéo non-cryptés de drones transitant par satellite en utilisant un logiciel de piratage de chaînes de télévision à péage ne coutant que 26 dollars.
[4] Les développements récents du drone journalism vont en ce sens.
[5] Comme les mines antipersonnel ou certaines armes classiques régies par la convention d'Ottawa ou la convention sur les armes inhumaines. Les robots létaux autonomes n'entrent pas, pour l'heure, dans les armes ciblées par ces conventions internationales.
[6] Les débats débuteront à l'Office des Nations Unies à Genève, à partir du 13 mai 2014, dans le cadre de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.