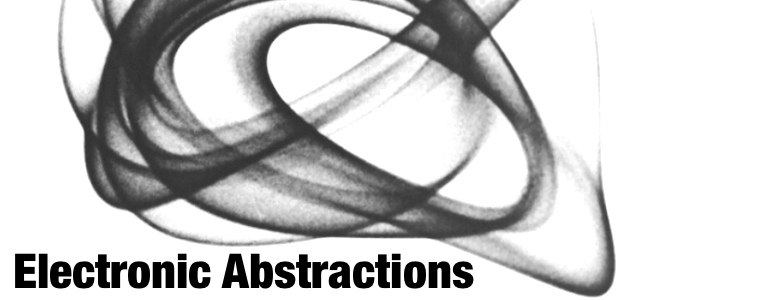- La thématique de la soumission (Conception de l'objet, Expérimentation et observation, Analyse)
- La discipline de l'auteur
- Le type de soumission (Présentation & table ronde, Atelier, Démonstration, Installation, Poster)
mardi 9 juillet 2024
[AAC] Drôles d'Objets 2025
lundi 11 décembre 2023
Soft control: behavioral matter & the art of replicability / .able
Soft control: behavioral matter & the art of replicability
Ana Piñeyro & Joffrey Becker - November 09, 2023
Intertwining the work of designer Ana Piñeyro and anthropologist Joffrey Becker, this video essay presents an archeology of the processes involved in the transformation of matter and the manifestation of its behavior. It addresses the epistemological question of the reproducibility of results.
.able is an image-based multi-platform journal at the intersection of art, design, and sciences, responding to the complexities of contemporary society and environmental concerns.
Find the article on .able: https://able-journal.org/en/soft-control/
Credits
Authors: Ana Piñeyro and Joffrey Becker
Visual designer: Ana Piñeyro
Sound designer: Joffrey Becker
Editorial mediation: Joffrey Becker
Dialogue recording: Christian Phaure, École des Arts Décoratifs
Financial support: La Chaire Beauté·s PSL – L’Oréal
Acknowledgments: Gwenaëlle Lallemand; Samuel Bianchini; La Chaire arts et sciences, of the École polytechnique de l’École des Arts Décoratifs – Université PSL and the Fondation Daniel et Nina Carasso.
dimanche 30 octobre 2022
Dissect - Berlin Science Week
lundi 18 juillet 2022
[AAC] Droles d'objets 2023
- La thématique de la soumission (Conception de l'objet, Expérimentation et observation, Analyse)
- La discipline de l'auteur
- Le type de soumission (Présentation & table ronde, Atelier, Démonstration, Installation, Poster)
- 31 octobre 2022 : Date limite de soumission
- Février 2023 : Notification aux auteurs
mardi 12 avril 2022
c:o/re Workshop: Interdisciplinary Research in Robotics and AI
lundi 24 janvier 2022
Drôles d'Objets - Conférence de cloture
lundi 27 septembre 2021
Conférence Drôles d'Objets - Un nouvel art de faire / La Rochelle 27-29 oct. 2021
Inscriptions en ligne sur le site : https://drolesdobjets20.sciencesconf.org
mardi 25 mai 2021
ICRA 2021 - Sentimental Machines
Our paper "Picking Up Good Vibrations: Designing an Experimental Setup to Assess the Role of Vibrations in Human-Robot Interaction" will be presented at the IEEE International Conference on Robotics and Automation on June 4, 2021 – 10:00AM CET.
*
Joffrey Becker, Samuel Bianchini, Hugo Scurto, Elena Tosi Brandi, "Picking Up Good Vibrations: Designing an Experimental Setup to Assess the Role of Vibrations in Human-Robot Interaction", IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation, ICRA’21, Sentimental Machines, Xi’an, 2021
Abstract: Focusing on behavioral objects (considered as art and design objects which are not figurative nor utilitarian), this article describes a first step in the design of a research and creation project called The Appprentices. Conceived as an environment containing three behavioral objects which movements are amplified, The Appprentices constitutes an experimental platform which aims to contribute to a better understanding of the modalities by which humans and objects are in a situation of nonverbal communication. The project aims to contribute to the study of animism in human-robot interaction (HRI) but also to the study of analogical forms of communication generally prevailing in multi-species interaction. It therefore implies to pay a particular attention to the design of a shared space. Reviewing several works in the field of art and design where vibration plays a central role, we address a dimension of animism that is still poorly studied in HRI anthropology, based not on the idea that objects are considered as persons but rather that their collective activities can be considered by analogy with social life. We then identify vibration as a relevant modality for relating human and nonhuman collectives, which allows a frame for interaction within which vibratory signals can be exchanged and embodied. The article concludes with a description of the architecture of the shared vibratory space designed for the project.
Conference website: https://roboticart.org/icra2021
Registration (free): https://www.eventbrite.co.uk/e/sentimental-machines-workshp-during-icra21-conference-tickets-155505116991
mercredi 26 juin 2019
Drôles d'objets - Appel à soumission
- La thématique de la soumission (Conception de l'objet, Expérimentation et observation, Analyse)
- La discipline de l'auteur
- Le type de soumission (Présentation & table ronde, Atelier, Démonstration, Installation, Poster)
mardi 5 mars 2019
IA : L’Homme a-t-il convoqué le diable ?
Programme : http://rvbn.fr/2019/project/les-cogitations
jeudi 20 décembre 2018
Trisha Brown et les cyborgs
http://www.joffreybecker.fr/pdf/JBecker_LesForcesDeLAttraction.pdf
Lorsqu'on songe aux représentations artistiques de la présence humaine dans l'espace les « vues d'artistes » viennent immédiatement à l'esprit. Les arts de la performance entretiennent eux aussi des liens étroits avec le domaine de l'exploration spatiale, partageant avec ce dernier un souci commun pour la vie humaine dans ce qu'elle a de plus banal et cherchant, par le biais de techniques spécifiques, à déplacer les conditions caractérisant l'existence terrestre dans un environnement étranger.
Émergeant progressivement au milieu des année 1960, l’intérêt de Trisha Brown pour la gravité nait avec Planes, en 1968, et il est intimement lié au contexte de conquête de l’espace. Avec le voyage spatial, il apparaît désormais que la gravité est un élément conditionnant la vie sur Terre. Cet intérêt va donner naissance à plusieurs travaux chorégraphiques entre 1968 et 1971, les Equipment Dances. Dans ces pièces, un mouvement simple de marche est mis en tension par des structures architecturales spécifiques, comme des murs ou des objets.
« J’ai été associée à la construction d’accessoires gigantesques et à des systèmes techniques permettant à des êtres humains de marcher sur des murs, de descendre la façade d’un immeuble de sept étages, d’apparaitre en chute libre ou suspendus dans un espace neutre – des travaux au centre desquels les préoccupations principales sont l’anti-gravité et le mouvement ordinaire tel qu’il apparaît dans des circonstances extraordinaires. » (Trisha Brown, 1973, « Group Primary Accumulation »)Avec Walking on the wall, Trisha Brown ne décontextualise pas seulement une action en la verticalisant, brouillant par conséquent les repères spatiaux ordinaires des spectateurs. La performance comporte aussi une dimension phénoménologique qui déplace l’expérience même des danseurs en les obligeant d’une certaine manière à réapprendre à marcher. Marcher sur un mur en étant soutenu par des fils eux-mêmes accrochés à un rail n’est, on peut s’en douter, pas chose banale. Et c’est tout l’enjeu de l’expérimentation que de donner à voir ce déplacement au public.
 |
| Steve Paxton, Trisha Brown, Walking on the Wall, Whitney Museum of American Art, NY. Photo - Carol Goodden 1971 |
Il est difficile de savoir dans quelle mesure Trisha Brown a eu connaissance des travaux menés au Langley Research Center dans les années 1960. Les installations de la base aérienne ont fait l’objet d’un reportage télévisé en 1968, durant lequel le présentateur et journaliste de CBS Walter Cronkite s’est essayé au simulateur de gravité lunaire installé pour entrainer les astronautes. Susan Rosenberg note par ailleurs que le travail de Trisha Brown a suscité l’intérêt du directeur de la revue Astronautics & Aeronautics qui, dans une lettre écrite en 1976, l’enjoint à visiter les installations de la base aérienne. Il est en fait de peu d’importance de chercher à déterminer comment l’artiste américaine a eu l’idée de Walking on the wall.
Le contexte des années 1960 est traversé d’un engouement populaire sans précédent pour la représentation du corps humain dans l’espace. Le travail sur le rôle de la gravité dans la danse mené par Trisha Brown s’inscrit dans les questions scientifiques et techniques posées en son temps. Et ces questions traversent bien plus largement le champ des arts, où elles prennent parfois la forme d’étranges machines, mixte de tâches humaines et d’équipement technique.
La simulation de la gravité lunaire menée par la division de mécanique spatiale du centre de recherche de Langley présente des ressemblances évidentes avec le travail de la chorégraphe américaine. Cette recherche ambitionne de comprendre comment des gestes aussi ordinaires que marcher, sauter, courir, monter et descendre une échelle peuvent être accomplis lorsqu’ils sont réalisés dans des conditions de gravité ne représentant qu’un-sixième de la gravité terrestre. Ces expérimentations ressortent d’un même logique de programmation de l’activité corporelle et d’un même souci pour le déplacement des activités ordinaires dans une architecture transformée.
 |
| Un astronaute au Langley Research Center (NASA courtesy photo/Released) |
Le déplacement de la banalité a ainsi un prix, qui est celui de la technique. Pour que le corps humain agisse au-delà des frontières terrestres, il lui faut être équipé, augmenté, et même « refait pour vivre dans l’espace », ainsi que le suggère un article paru dans Life Magazine le 11 juillet 1960, consacré aux travaux du psychiatre Nathan Kline et de l’informaticien Manfred Clynes, les pères de la notion de cyborg. Ce terme est né de la volonté de libérer l'humain des contraintes d'un environnement spatial bien trop complexe pour lui, sans pour autant remettre en question ses capacité intellectuelles, sa créativité, et son goût de l'exploration.
La notion décrit un corps étendu, s'appuyant sur des dispositifs techniques grâce auxquels il lui est possible d'agir. C'est en somme le corps que nous avons toujours eu. Ce corps qui a toujours été appareillé, toujours équipé de crayons, d'ordinateurs, ou d'institutions, de tous ces « outils » qui nous permettent d’échafauder et de transformer nos idées. Ce corps qui, « partout, sous des formes diverses mais toujours à quelques degrés, […] est l'objet de modifications ou d'adjonctions. » comme l'ont souligné Michel Leiris et Jacqueline Delange.
Or ce corps équipé, qui traverse le travail de Trisha Brown comme celui des ingénieurs du Langley Research Center, va bien au-delà des extensions matérielles décrites par la notion de cyborg. Pour en saisir la profondeur, il faut comprendre ce corps comme la combinaison subtile de l’activité des collectifs humains et des machines. Système socio-technique, plastique, en contradiction parfois avec lui-même, ou résistant à ses propres prérogatives, les agencements humains et matériels caractérisant la performance des danseurs et des astronautes forment la condition par laquelle il est possible de susciter l’imagination en variant les paramètres des conditions ordinaires d’existence.
Pour aller plus loin :
Rosenberg Susan, 2017, Trisha Brown, Choreography as Visual Art, Middletown, Wesleyan University Press
Reduced Gravity Simulator for Study of Man's Self Locomotion, NASA Langley CRGIS (Film)
lundi 13 mars 2017
Ce que les robots nous disent de l'art

J'ai le plaisir de signer cet article pour le Huffington Post parallèlement à la conférence que j'ai donnée lors de l'événement l'Ethnologie va vous surprendre - Têtes chercheuses, au Musée du quai Branly.
L'article est consultable à l'adresse suivante : https://www.huffingtonpost.fr/joffrey-becker/ce-que-les-robots-nous-disent-de-l-art_a_21721037/
mardi 21 février 2017
L'ethnologie va vous surprendre !
mercredi 10 février 2016
Des robots et des Hommes
 |
| Photo : Max Aguilera-Hellweg (http://aguilerahellweg.com) |
Des robots et des Hommes
Expositions / Installations / Conférences / Projections
Centre Culturel de Bellegarde / Toulouse
Du 7 au 30 Avril 2016
jeudi 21 janvier 2016
Automates et robots musiciens
 Séminaire "Geste, instrument de musique, technologie"
Séminaire "Geste, instrument de musique, technologie" Baptiste Bacot, Nicolas Donin
Vendredi 22 janvier à 15h
EHESS
105 Bd Raspail
75006 Paris
Salle 11
Joffrey Becker : Automates et robots musiciens
jeudi 7 janvier 2016
Conférence-dédicace, Joffrey Becker & Zaven Paré
Afin de comprendre la singularité des robots, au sein des laboratoires du Robot Actors Project de l’université d’Osaka et de l’Institut de recherche ATR de Kyoto, il faut les observer, encadrés par un double héritage, celui des sciences mais aussi celui des arts. Zaven Paré, artiste expérimentateur, observe non seulement la manière dont nous nous attachons aux robots (quasiment malgré nous) mais aussi cette étrange mise en scène de machines qui nous ressemblent parfois étrangement.
http://www.georgesand95.fr/georgesand95.fr/cms/articleview/id/388
Persona, étrangement humain
 Persona, étrangement humain
Persona, étrangement humain Actes Sud - Musée du quai Branly
Emmanuel GRIMAUD, Thierry DUFRENE, Denis VIDAL, Anne-christine TAYLOR (éd.)
jeudi 26 novembre 2015
L’expérience esthétique
lundi 28 septembre 2015
Table ronde : Des hommes et des robots
Jeudi 1er octobre 18:00-19:30
Maison de l’étudiant
3, passage Jacqueline de Romilly
La Rochelle
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
http://www.univ-larochelle.fr/Table-ronde-Des-hommes-et-des
Pour répondre à ces questions, un panel d’invités :
samedi 25 octobre 2014
Journées d'étude sur le geste : « Main, mouvement et émotion »
Stéréolux, Nantes
D’une simplicité extrême, le geste de la main est là pour marquer toute communication humaine : on se fait signe. Codifié, il devient langage. Esthétisé, il devient source de composition artistique. Comment les technologies numériques peuvent-elles enrichir notre rapport au geste ? Des experts de plusieurs disciplines s’intéresseront au geste de la main à l’ère du numérique, à ses enjeux tant philosophiques que techniques ou esthétiques : Comment le représenter, l’archiver ? Comment cartographier ses transformations en fonction des cultures et des sociétés ? Conférences, débats et workshops en partenariat avec l’Artmap et l’IRRCyN (équipe IVC).
Inscriptions : http://www.stereolux.org
PROGRAMME
Jour 1 - Jeudi 6 novembre
9h30 – 13h00 > Séminaire
9h30 - Introduction
10h00 - Baptiste BACOT, Doctorant à l’EHESS : Geste, corps et instrument dans la musique électronique
10h30 - parole au modérateur
10h45 - Joffrey BECKER, Anthropologue, Musée du quai Branly / ArtMAP : Polyvalence et dextérité : éléments d'une ethnographie de l'imitation de la main en robotique
11h15 - parole au modérateur
11h20 - Harold Mouchère et Christian VIARD, IUT de Nantes Département GEII - IRCCyN/IVC : L'écriture, un micro-geste riche de sens
11h45 - parole au modérateur
12 h00 - Pierre GUFFLET, Artiste digital-media, concepteur, programmateur
12h30 - Stéphane RENNESSON - Modérateur, Anthropologue, chargé de recherches au Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative
14h30 – 17h30 > Ateliers
Objectif des ateliers : Le principe général des ateliers est de penser le geste comme objet de recherche transdisciplinaire : qu’est-ce qu’un geste ? Comment le définir ? Comment tracer son évolution ? L’objectif des ateliers est de fabriquer un outil, d’abord théorique, puis technique ou technologique de « cartographie » du geste. Programme des ateliers
14h30 - Introduction : Reprise des questions générales soulevées au cours de la matinée par le modérateur dans une dimension technique et technologique. Quelles sont les limites ou les contraintes posées par tel ou tel type d’outil de captation du geste ?
15h00 – liste de questions et catégories d’accès : Au cours d’une table ronde nous organiserons une reprise des questions posées par les participants durant la matinée. Comment à répondre à tel ou tel intérêt ; tel ou tel croisement interdisciplinaire ?
16h00 – brainstorming : Organisation de modules de travail (en groupes) en vue de la formulation d’un projet d’outil de notation du geste (captation / écriture). Partant des problèmes concrets posés par chaque expert pour chaque domaine d’expertise : quelles sont les limites théoriques l’outil de captation du geste ? Comment modéliser la représentation graphique du geste ?
17h00 - synthèse et critique : Exposition des résultats et synthèse pour chaque groupe. Critique du modèle présenté par chaque groupe
Jour 2 - Vendredi 7 novembre
10h00 – 12h30 > Séminaire
10h00 - Julien TOUATI, Danseur chorégraphe, AVS Road Compagny
10h30 - parole au modérateur
10h45 - Anne DUBOS, Anthropologue, Visual Artist, AVS Road Compagny : Emergence, captation et analyse du geste : comment interpréter l’hypothèse de la greffe de code (Deleuze) ?
11h15 - Gaëlle FERRÉ, Maître de Conférences, Faculté des Langues et Cultures Etrangères (FLCE) & Laboratoire de Linguistique de Nantes (LLING) : Geste et parole : interaction entre les différentes modalités d'encodage de l'information
11h45 - parole au modérateur
11h50 - Laurent GUIDO, Professeur des Universités, Le CREAC, Lille III
14h00 - 17h00 > Ateliers
Programme identique à celui de la veille