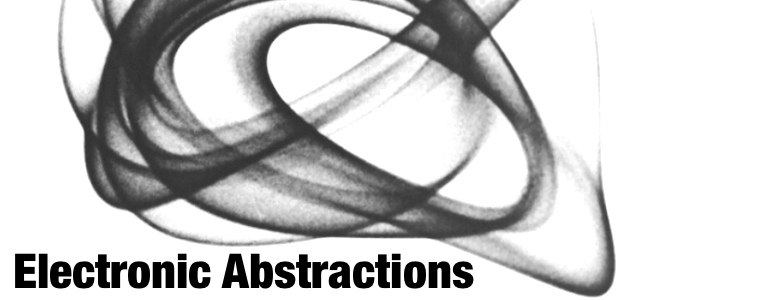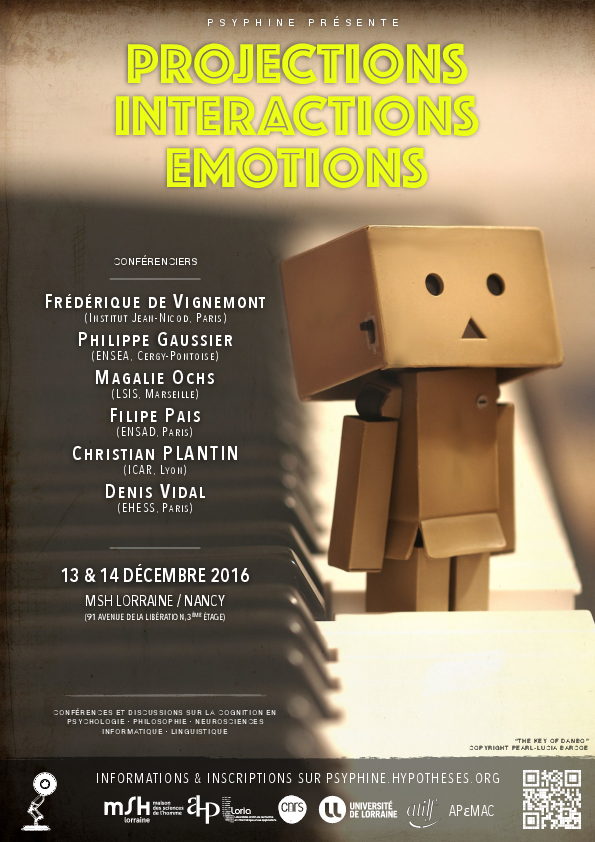Drôles d'objets
Un nouvel art de faire
Nancy
15 - 17 mai 2023
En association avec le festival Musique Action
du CCAM / Scène nationale de Vandœuvre
Robots, artefacts autonomes, objets connectés : comment concevoir et appréhender ces drôles d’objets qui renouvellent nos interactions avec les autres comme avec le monde ?
Nous sommes de plus en plus souvent invités à entrer en relation avec des robots ou des machines, que ce soit à des fins pratiques (thérapeutiques, professionnelles, scientifiques) ou ludiques. Ce type de relation semble dépasser rapidement le simple usage fonctionnel, la réaction automatique et l’action mécanique, pour s’ouvrir à quelques interactions lors desquelles nous tentons d’interpréter le comportement de ces objets. Pourquoi et comment sommes-nous tentés d’interagir avec ces objets insolites qui s'animent, bougent et évoluent ? L'étude de ces objets intéresse des champs très divers des sciences, des arts et du design. Quelles méthodes adopter toutefois pour expérimenter, observer et analyser ces interactions ?
Robotique, IA, art et design, anthropologie, psychologie, philosophie, sciences du langage… chaque domaine développe ses propres notions, outils, souvent dans des contextes pluridisciplinaires. Quelles réponses la philosophe peut-elle apporter au roboticien ? En quoi la psychologie peut se nourrir du travail de l'anthropologue ? Les artistes peuvent-ils contribuer à la sociolinguistique des interactions ?
L’objectif de cette conférence est de croiser les regards des disciplines et pratiques scientifiques sur ces nouveaux objets et les interactions qu’ils suscitent.
L'interdisciplinarité sera dans ce contexte pratiquée, expérimentée et discutée à partir de formes concrètes qu'elle prend et des tentatives (fructueuses ou non) qu'elle déploie. Ainsi, les discussions seront organisées sous forme de tables-rondes autour de trois grandes questions sur la thématique de l'interaction avec des objets animés:
Conception de l'objet : à quoi doit ressembler un objet animé ?
Comment conçoit-on un objet animé interactif ? Quels sont les paramètres, les caractéristiques et les propriétés de ces objets (forme, design, fonctionnalité) sur lesquels on peut jouer pour qu'un objet animé devienne un "partenaire" à nos yeux ? Quels sont les outils, les savoirs, les technologies que l'on peut mobiliser ? Dans quelle mesure le protocole expérimental influence-t-il et contraint-il la conception ? Peut-on et doit-on envisager une conception frugale ? Quelle place pour l'utilisateur dans la conception ?
Expérimentation et observation : comment concevoir une expérience ?
Comment bien comprendre ce qui se joue lors d’une interaction avec un objet animé ? Que peut-on mesurer, que peut-on évaluer, que peut-on observer ? Les approches qualitatives et quantitatives peuvent-elles se répondre, se nourrir, s'opposer ? Dans quelle mesure la temporalité de la confrontation influence-t-elle le résultat de l'expérimentation ? Dans quelle mesure l'observation en milieu naturel permet-elle de dépasser les limitations des expérimentations en laboratoire ? Quels sont les lieux de l'interdisciplinarité ?
Analyse : que retirons-nous de ces expériences ?
Comment interpréter les données issues d'expérimentations avec des objets animés ? Quelle confiance accorder au témoignage des sujets ? L'interprétation est-elle indépendante de toute évaluation éthique de l'interaction ? Quels sont les modèles et les théories mobilisables ? Comment intégrer des méthodes d'analyses multiples ? Ces travaux peuvent-ils éclairer les usages croissants du numérique ? Quels problèmes éthiques et politiques soulèvent ces drôles d'objets ?
En outre, nous disposerons d'espaces de conception et d'expérimentation pour présenter les ateliers, démonstrations et installations sélectionnés, qui offriront des occasions de confronter les approches, d'affiner les questions et de prolonger les discussions.
Mots-clefs : arts/sciences, création, émotion, empathie, expérimentation, expression, intentionnalité, interaction, interdisciplinarité, interprétation, modèles, observation, perception, projection, robots.
Soumissions & formats
Les soumissions, 5000 signes, notes, espaces et bibliographies comprises, devront être envoyées pour le 31 octobre 2022.
Elles devront préciser :
- La thématique de la soumission (Conception de l'objet, Expérimentation et observation, Analyse)
- La discipline de l'auteur
- Le type de soumission (Présentation & table ronde, Atelier, Démonstration, Installation, Poster)
Dates importantes
- 31 octobre 2022 : Date limite de soumission
- Février 2023 : Notification aux auteurs
Comité Scientifique
Frédéric Alexandre, Virginie André, Salvatore Anzalone, Valérie Aucouturier, Heike Baldauf-Quilliatre, Joffrey Becker, Samuel Bianchini, Arnaud Blanchard, Yann Boniface, Amine Boumaza, Dominique Deuff, Olivier Duris, Alain Dutech, Carole Etienne, Valeria Giardino, Emmanuelle Grangier, Jean-François Grassin, Xavier Hinaut, Diego Jarak, Justine Lascar, Florent Levillain, Ghiles Mostafaoui, Guillaume Nassau, Magalie Ochs, Filipe Pais, Catherine Pelachaud, Alexandre Pitti, Christian Plantin, Manuel Rebuschi, Arnaud Revel, Nicolas Rougier, Lucile Sassatelli, Lucien Tisserand, Serge Tisseron, Julien Toulze, Natacha Vas-Deyres, Frédéric Verhaegen, Denis Vidal, Marion Voillot, Elisabetta Zibetti.
La précédente, et première édition, a fini par pouvoir se tenir en 2021 à La Rochelle.
Les soumissions, articles longs et la conférence publique finale peuvent être consultés sur la page :