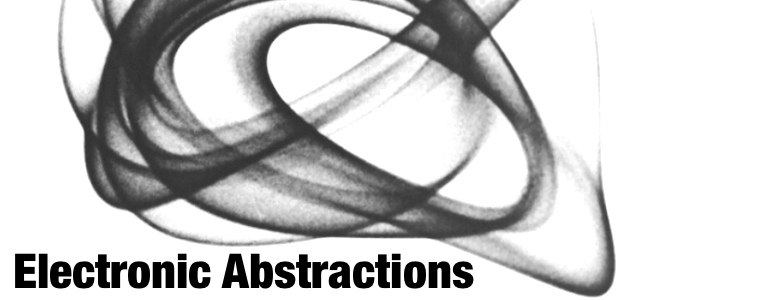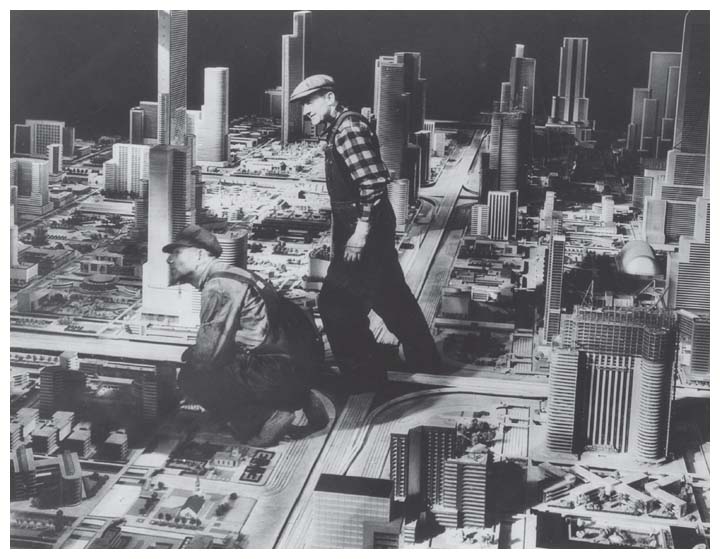APPEL À CONTRIBUTIONS
Philosophia Scientiae lance un appel à contributions pour un numéro spécial sur le thème suivant :
RECONFIGURATIONS ROBOTIQUES
Éditeurs invités :
Joffrey Becker & Julien Wacquez
(ETIS, UMR8051 - CY Cergy Paris Université, ENSEA, CNRS)
*
Date limite de soumission : 1er janvier 2025 1er février 2025
Date de notification : 1er avril 2025 30 avril 2025
Version finale : 1er septembre 2025
Adresses de soumission : joffrey.becker@ensea.fr ; julien.wacquez@gmail.com
Appel à contributions [Fr] : https://journals.openedition.org/philosophiascientiae/4391
Call for contributions [En] : https://journals.openedition.org/philosophiascientiae/4396
Les machines dites intelligentes sont de biens drôles d’objets. Leur existence est source de confusion et d’ambiguïté. Elles suscitent la curiosité et l’enthousiasme, mais aussi le malaise et parfois l’anxiété. Ces objets ont désormais intégré d’innombrables domaines de la vie sociale. Malgré leur invisibilité flagrante, les processus autonomes s’introduisent partout, transformant notre regard sur la vie et le vivant, le travail, les relations, les soins, les relations amoureuses ou la guerre. Dans ce moment que certains qualifient volontiers d’historique, il ne se passe pas une semaine sans que les systèmes intelligents ne soient évoqués dans les journaux, suscitant de nouveaux espoirs, de nouvelles controverses, de nouveaux fantasmes et de nouvelles angoisses.
Les travaux menés dans les domaines de l’informatique, du génie électrique et du génie mécanique ont fait de ces disciplines les principaux acteurs de la robotique. Cependant, d’autres domaines se sont également emparés des questions soulevées par ces objets. Du point de vue des sciences humaines et sociales, par exemple, de nombreuses études se concentrent sur les questions épistémologiques (Rebuschi, 2021 ; Becker, 2023), culturelles (Wright, 2018 ; Grimaud, 2021), éthiques (Khamassi, Chatila & Mille, 2019) et sociales liées à l’IA et à la robotique (Casilli, 2019 ; Nassau, 2021). L’art et le design envisagent également d’autres manières de fabriquer ces objets, ainsi que de nouvelles formes d’interaction autour de leurs comportements (Becker, 2015 ; Bianchini & Quinz, 2016 ; Quinz, 2021). L’IA, en particulier lorsqu’elle dote les artefacts d’une capacité d’animation et d’interaction, constitue un objet frontière (Star & Griesemer, 1989) : elle agrège des intérêts très divers et, ce faisant, permet de croiser les disciplines, les perspectives et les méthodes (Psyphine, 2022).
Anticiper l’impact de la robotique et de l’IA sur la société est devenu une sorte d’obsession contemporaine. Ce questionnement n’est pourtant pas récent dans le champ des sciences sociales et des humanités. Lucy Suchman, par exemple, a été l’une des premières chercheuses à étudier les reconfigurations liées à l’introduction des machines dans les relations, en se concentrant sur les problèmes de communication entre humains et systèmes automatiques (Suchman, 2007). Les asymétries qu’elle a observées relèvent de la différence de nature entre les machines dites intelligentes et leurs utilisateurs, et posent la question de leur qualification. Or, si la constitution mutuelle des corps et des machines est un enjeu anthropologique majeur (Suchman, 2007 ; Becker, 2015), les recherches menées dans les domaines de la robotique et de l’IA impliquent d’étudier des transformations qui vont bien au-delà du simple face-à-face avec des machines dont l’anthropomorphisme (un thème récurrent de la littérature sur les robots) fascine autant qu’il distrait. Ce numéro thématique cherche à étendre la réflexion au-delà du seul rapport à l’ontologie des robots.
Il cherchera en particulier à aborder les questions de relation, d’arrangement, d’association, d’assemblage et d’accommodation entre humains et machines (Velkovska & Relieu, 2021). Le numéro portera par exemple l’intérêt sur la manière dont ces objets techniques sont pris dans un réseau au sein duquel ils assignent des places spécifiques (Akrich, 1987 ; 1989 ; Woolgar, 1990), sur la manière dont ils distribuent des identités, des matériaux ou des actions humaines (Gell, 1998), sur leur rôle dans l’agencement mutuel des humains, des instruments, des objets et des pratiques dans les sciences (Knorr-Cetina, 1999), ou encore sur l’hybridité particulière qu’ils établissent en contribuant à coordonner la participation de différents agents à une action commune (Pitrou, 2017). En se focalisant sur les reconfigurations impliquées par leur mise en œuvre, ces orientations invitent à considérer le rôle médiateur des objets techniques.
Quelle est l’ampleur de ces reconfigurations ? Que se passe-t-il à l’interface des relations entre humains et systèmes dits intelligents ? Si la situation expérimentale d’interaction avec des robots anthropomorphes contribue à redéfinir les représentations que les humains se font de leur corps, les systèmes dits intelligents jouent également sur d’autres registres et interviennent à d’autres échelles. Quels sont-ils ? Dans quelles temporalités opèrent-ils ? Et quelles échelles de la vie sociale impliquent-ils ? Ce numéro thématique s’articulera autour de quatre grands axes.
1/ L’épistémologie des systèmes dits intelligents
Comme les automates de l’âge classique, les machines intelligentes s’inscrivent dans un effort qui concerne à la fois les connaissances théoriques et le champ des applications. Elles cherchent leur voie entre une approche mimétique et pragmatique (Star, 1988 ; Riskin, 2003), c’est-à-dire entre la compréhension des phénomènes qu’elles cherchent à imiter et l’ensemble des contraintes liées aux techniques ou aux matériaux utilisés pour atteindre ce but. Les fonctions vitales sont une source d’inspiration pour penser la vie et les processus vitaux. Il en résulte une approche du vivant basée sur l’artefact, une biologie limite (Helmreich, 2011), où la “vie telle qu’elle pourrait être” repose sur la pratique de l’analogie (Thom, 1979) tout en reproduisant des visions déjà existantes de la “vie telle qu’elle est” (Helmreich, 1998). Il s’agira d’examiner cet espace trouble, entre la robotique bio-inspirée et la biologie inspirée par les machines (Datteri & Tamburrini, 2007 ; Tamborini, 2021), qui semble caractériser l’épistémologie roboticienne.
2/ L’anthropomorphisme formel ou comportemental et ses effets dans l’interaction
Il s’agira également de porter l’attention à la façon dont les robots dits sociaux tendent à reconfigurer les relations que nous avons avec nos objets. S’ils peuvent imiter l’apparence humaine, les gestes des robots ne nous semblent jamais clairement familiers (Mori, 1970). Nous reconnaissons presque toujours leur nature mécanique (Grimaud et Paré, 2011 ; Becker, 2015 ; Vidal, 2017). Ils restent à nos yeux des boîtes noires dont nous ne comprenons pas le fonctionnement (Suchman, 2007). En cela, ils rejoignent un ensemble beaucoup plus large d’objets, le plus souvent à vocation rituelle (Vidal, 2007 ; Severi, 2007, 2017 ; Dufrêne et al., 2016), qui intéressent particulièrement la recherche anthropologique. Comme beaucoup d’autres objets étudiés par les anthropologues, ils véhiculent des représentations de la vie et des relations sociales, et contribuent à en définir les frontières (Helmreich, 1998 ; Héritier, 2007 ; Coupaye et Pitrou, 2018). Quels effets ont-ils sur nous ? Devient-on animiste au contact des robots ? Comment caractériser l’interaction humain-robot / humain-système ?
3/ Les configurations socio-techniques et les reconfigurations initiées par la robotique
Au-delà des relations de face à face, ce numéro s’intéressera également à la manière dont les machines dites intelligentes s’insèrent dans les activités humaines. La robotique et l’informatique considèrent la vie dans ce qu’elle a de plus ordinaire. Nos routines sont désormais un élément clé de leur travail, ce qui a conduit à la conception d’objets capables d’intégrer les activités humaines dans leur fonctionnement dans des secteurs allant des soins de santé (Jacob Rodrigues, Postolache & Cercas, 2020) au contrôle du trafic (Dimitrakopoulos & Demestichas, 2010). Les systèmes dits intelligents ne se limitent pas à agir sur nos connaissances et nos représentations de la vie, ou sur les relations que nous entretenons avec nos objets. Ce sont aussi des dispositifs techniques dans lesquels nous inscrivons nos activités sociales. Ils affectent les relations entre les acteurs et contribuent à réorganiser leurs activités. Qu’il s’agisse de robots cognitifs (par exemple à caractère social) ou d’architectures informatiques capables d’actions réflexes (par exemple lancer des alertes), ces objets nous invitent à être attentifs à la place qu’ils prennent dans les systèmes sociotechniques et aux rôles qu’ils font jouer aux humains (Akrich, 1987 ; 1989).
4/ Les imaginaires robotiques ou la robotisation des imaginaires
Enfin, ce dossier explorera la relation complexe qu’entretiennent les robots, cyborgs, machines et autres systèmes dits intelligents avec la fiction et la narration. D’un côté, les scientifiques font sens de leurs propres recherches en les insérant dans des récits (Gusfield 1980). De l’autre, les machines qu’ils conçoivent (ou peut-être celles dont ils rêvent) circulent beaucoup plus largement au sein de la société à travers les œuvres de science-fiction. Que gagnerait-on à écrire une histoire conjointe des sciences et des fictions robotiques ? L’une confère-t-elle sa forme à l’autre ou s’agit-il de deux domaines irrémédiablement séparés ? Ces rapports entre science et fiction se compliquent à la suite des évolutions récentes que connaissent chacun de ces domaines. D’une part, de nouveaux usages des récits de science-fiction se développent au sein même des disciplines scientifiques (Milburn 2010), des sciences humaines et sociales (Mengozzi & Wacquez 2023) et des organisations publiques et privées (Galison 2016 ; Roussie et al. 2022) – en en faisant un outil à penser des altérités ou des alternatives, un outil de prospective pour anticiper les futurs possibles (Grimaud & Wacquez 2023). D’autre part, les machines elles-mêmes deviennent des outils à produire des fictions (Gefen 2023). À mesure qu’elles s’immiscent toujours plus profondément dans nos vies sociales et culturelles, peut-on parler d’une robotisation des imaginaires ?
Modalités de soumission
Les manuscrits devront :
- être originaux, et ne peuvent pas être en cours de soumission pour une autre publication ;
- être rédigés en anglais ou en français ;
- ne pas dépasser 50 000 caractères (espaces, résumés, bibliographie et notes compris) ;
- être préparés pour une évaluation anonyme en double aveugle ;
- contenir un résumé en français et un résumé en anglais (env. 15 lignes) ;
- être au format Word, OpenOffice ou LaTex (https://journals.openedition.org/philosophiascientiae/449) ;
- être envoyés avant le 1er janvier 2025 à joffrey.becker@ensea.fr et julien.wacquez@gmail.com
Pour le format de l’article, consulter les instructions aux auteurs : https://journals.openedition.org/philosophiascientiae/452
Bibliographie
Akrich, Madeleine [1987], Comment décrire les objets techniques ?, Techniques & culture, 9, 49-64. Akrich, Madeleine [1989], La construction d’un système socio-technique : Esquisse pour une anthropologie des techniques, Anthropologie et sociétés, 13(2), 31-54. Becker, Joffrey [2015], Humanoïdes, Expérimentations croisées entre arts et sciences, Nanterre : Presses Universitaires de Paris Ouest. Becker, Joffrey [2023], Artificial Lives, Analogies and Symbolic Thought: An Anthropological Insight on Robots and AI, Studies in History and Philosophy of Science, 99, 89-96. Bianchini, Samuel, Quinz, Emanuele (Ed) [2016], Behavioral Objects I, A Case Study: Céleste Boursier-Mougenot, Berlin-New York : Sternberg Press - MIT Press. Casilli, Antonio [2019], En attendant les robots : Enquête sur le travail du clic, Paris : Seuil. Coupaye, Ludovic, Pitrou, Perig [2018], The Interweaving of Vital and Technical Processes in Oceania, Oceania, 88(1), 2-12. Datteri, Edoardo, Tamburrini, Guglielmo [2007]. Biorobotic Experiments for the Discovery of Biological Mechanisms, Philosophy of Science, 74(3), 409-430. DOI : 10.1086/522095 Dimitrakopoulos, George, Demestichas, Panagiotis [2010], Intelligent Transportation Systems. IEEE Vehicular Technology Magazine, 5(1), 77-84. Dufrêne, Thierry, Grimaud, Emmanuel, Taylor-Descola, Anne-Christine, Vidal, Denis (ed.) [2016], Persona : étrangement humain. Arles : Musée du quai Branly/Actes Sud. Galison, Peter [2016], Quand l’État écrit de la science-fiction, Angle Mort, 12, accessible en ligne : https://www.angle-mort.fr/fiction/quand-letat-ecrit-de-la-science-fiction/ Gefen, Alexandre (Ed) [2023], Créativités artificielles – La littérature et l’art à l’heure de l’intelligence artificielle. Paris : Les Presses du réel. Gell, Alfred [1998], Art and Agency, An anthropological theory, Oxford : Clarendon Press. Grimaud, Emmanuel [2021], Dieu point zéro : Une anthropologie expérimentale, Paris : PUF. Grimaud, Emmanuel, Paré, Zaven [2011], Le jour où les robots mangeront des pommes : conversations avec un Geminoïd. Paris : Petra. Grimaud, Emmanuel, Wacquezn Julien [2023], Le vertige futurologique, Terrain, 79, 2-25. Gusfield, Joseph [2009], La culture des problèmes publics. L’alcool au volant : la production d’un ordre symbolique. Paris : Economica, coll. “études sociologiques”. Helmreich, Stefan [1998], Silicon Second Nature, Culturing Artificial Life in a Digital World, Berkeley: University of California Press. Helmreich, Stefan [2011], What was life? Answers from three limit biologies, Critical Inquiry, 37(4), 671-696. Héritier, Françoise [2007], Chimères, artifices et imagination. in J.-P. Changeux, L’Homme artificiel, Colloque annuel, Paris : Odile Jacob, 39-59. Jacob Rodrigues, Mariana, Postolache, Octavian, Cercas, Francisco [2020], Physiological and Behavior Monitoring Systems for Smart Healthcare Environments: A Review, Sensors 2020, 20, 2186. Khamassi, Mehdi, Chatila, Raja, Mille Alain [2019] Éthique et sciences cognitives, Intellectica 70(1), 7-39. Knorr-Cetina, Karin [1999]. Epistemic Cultures, How the Sciences Make Knowledge, Cambridge : Harvard University Press. Mengozzi, Chiara, Wacquez, Julien [2023], On the Use of Science Fiction in Environmental Humanities and Social Sciences: Meaning and Reading Effects, Science Fiction Studies, 50(2), 145-174. Milburn, Colin [2010] Modifiable Futures: Science Fiction at the Bench. Isis, 101(3), 560-569. Mori, Masahiro [1970], Bukimi no tani (the uncanny valley), Energy, 7(4), 33-35. Nassau, Guillaume [2021], Le robot face à nous : interlocuteur ou objet de discussion ? Analyse interactionnelle d’une rencontre Homme-machine, Drôles d’objets : un nouvel art de faire, Oct 2021, La Rochelle, France. DOI : 10.5281/zenodo.6059653. Psyphine [2021], Que prêtons-nous aux machines ? Approches interdisciplinaires des interactions homme-robot, Nancy : PUN - MSH Lorraine. Pitrou, Perig [2017], Life Form and Form of Life within an Agentive Configuration: A Birth Ritual among the Mixe of Oaxaca, Mexico, Current Anthropology, 58(3), 360–80. Quinz, Emanuele [2021], Le comportement des choses, Paris : Les presses du réel. Rebuschi, Manuel [2021], Drôles d’objets ou drôles d’interactions ?. Drôles d’objets : un nouvel art de faire, Oct 2021, La Rochelle, France. DOI : 10.5281/zenodo.6059665. Riskin, Jessica [2003], The Defecating Duck, or the Ambiguous Origins of Artificial Life, Critical Inquiry. 29(4), 599-633. Roussie, Marie, Denis-Rémis, Cédric, Colas, Jean-Baptiste [2022], La Red Team Défense : quand la science-fiction permet aux armées françaises d’explorer le futur, Annales des Mines - Responsabilités & Environnement, 107(3) : 75-78. Severi, Carlo [2007], Le principe de la chimère : une anthropologie de la mémoire, Paris : Éditions Rue d’Ulm. Severi, Carlo [2017], L’objet-personne : une anthropologie de la croyance visuelle, Paris : Éditions Rue d’Ulm.. Suchman, Lucy [2007], Human-Machine reconfigurations, Plans and situated actions, 2nd Edition, Cambridge: Cambridge University Press. Star, Susan Leigh [1988], The Structure of Ill-Structured Solutions: Boundary Objects and Heterogeneous Distributed Problem Solving, in L. Gasser & M. N. Huhns (Ed), Distributed Artificial Intelligence, vol II. London – San Mateo, Pitman: Morgan Kaufmann Publishers, 37-55 Tamborini, Marco [2021], The Material Turn in the Study of Form: From Bio-Inspired Robots to Robotics-Inspired Morphology, Perspective on Science, 29(5), 643-665, DOI : 10.1162/posc_a_00388 Thom, René [1979], Modélisation et scientificité, in P. Delattre, & M. Thellier (Ed), Élaboration et justification des modèles, Actes du colloque, ENS, 9-14 oct. 1978, Tome 1. Paris : Maloine-Doin, 21-29. Velkovska, Julia, Relieu, Marc [2021], Pour une conception “située” de l’intelligence artificielle. Des interactions hybrides aux configurations socio-techniques, Réseaux, 229(5), 215-229. Vidal, Denis [2007], Anthropomorphism or sub-anthropomorphism ? An anthropological approach to gods and robots, Journal of the Royal Anthropological Institute, 13(4), 917-933. Vidal, Denis [2017], Aux frontières de l’humain : dieux, figures de cire, robots et autres artefacts, Paris : Alma. Woolgar, Steve [1990], Configuring the user: the case of usability trials, The Sociological Review, 38(1), 58-99. Wright, James [2018], Tactile care, mechanical Hugs: Japanese caregivers and robotic lifting devices, Asian Anthropology, 17(1), 24-39.