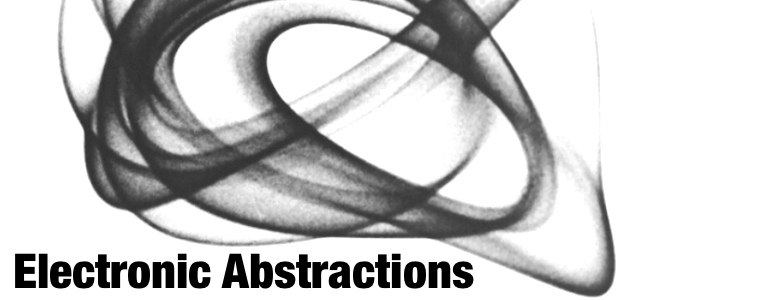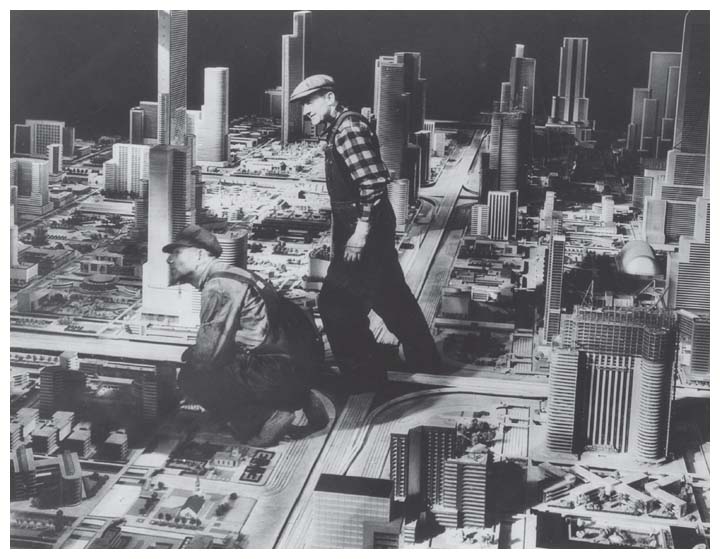Maîtriser l'IA au service de l'action publique
Une responsabilité individuelle et collective
Christian Paul et Daniel Le Métayer (dir.)
Berger Levrault / Au Fil Du Debat - Action Publique
Dans d’innombrables organisations publiques ou privées réalisant des activités de production de services, l’intelligence artificielle prend une place inimaginable il y a encore dix ans. L’accélération, permise par des apprentissages engloutissant des masses considérables de données et d’images, n’est pas un mythe.
Mais qu’en est-il réellement dans le monde public ? Où trouver les promesses tenues et les expérimentations marquantes ? Et surtout, qui assume la responsabilité d’éclairer et de maîtriser le déploiement de ces nouveaux systèmes auxquels beaucoup prêtent un immense avenir sans pouvoir en identifier ni l’agenda ni les risques ?
C’est la question centrale de cet ouvrage : comprendre comment les autorités publiques à tous les niveaux, les développeurs numériques et les entreprises, les citoyens/usagers jouent – ou ne jouent pas – un rôle dans l’histoire de l’intelligence artificielle mobilisée pour la transformation de l’action publique. Quelles responsabilités individuelles et collectives doit-on affirmer pour que cette grande aventure humaine et technologique ne vire pas au fiasco ou au cauchemar ?
À l’heure où s’écrit ce livre, l’intelligence artificielle ne révolutionne pas – ou pas encore – le monde public. Les applications les plus communément expérimentées ou déjà déployées ont pour principaux objectifs l’automatisation de tâches bureaucratiques répétitives, la surveillance, l’aide à la décision ou le diagnostic en santé.
Mais qu’en sera-t-il demain ? Que l’on conteste ses bienfaits ou que l’on redoute ses risques, l’intelligence artificielle contient néanmoins d’immenses potentiels. Ange ou démon ? Le débat public sur l’IA doit avoir lieu sans retard et sans tabous, en considérant ses multiples facettes. Il doit impliquer tous les acteurs concernés et reposer sur des faits plutôt que des idées préconçues. L’enterrer ou l’édulcorer serait une faute démocratique majeure.
Ce livre est le troisième titre de la collection « Au fil du débat-Action publique », créée par la chaire Transformations de l’action publique de Sciences Po Lyon en partenariat avec les éditions Berger-Levrault.
Lien : https://boutique.berger-levrault.fr/maitriser-l-ia-au-service-de-l-action-publique.html