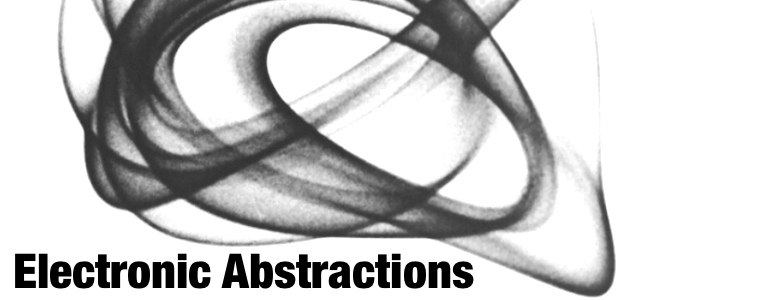Contrat Doctoral
Médiations Robotiques en Soins de Santé (MR2S)
À propos
Fondée en 1952, l’ENSEA est une école publique d’excellence qui forme des ingénieurs généralistes, reconnus dans le monde industriel et à l’international. Située aux portes de Paris, l’école s’est bâtie sur 3 piliers fondamentaux expertise, inclusivité et durabilité, qui sont au cœur de ses activités de recherche, d’innovation et d’enseignement.
Présentation du projet de thèse
Dans une perspective interdisciplinaire, ce projet de thèse vise à mieux saisir les dynamiques sociales et cognitives particulières que les dispositifs dits intelligents font émerger en s'appuyant principalement sur l’enquête ethnographique, les pratiques de conception collaborative et la méthode expérimentale. Son but est de concevoir, de tester et d’évaluer l’inscription de robots dits sociaux dans le processus thérapeutique en s’appuyant sur un objet robotique en situation de médiation. La recherche proposée vise à explorer le potentiel thérapeutique d’une machine à vocation sociale sans recourir à l’esthétique anthropomorphique ou zoomorphique mobilisée dans beaucoup d’études impliquant des robots en environnement de soin. Le projet vise trois principaux objectifs. Le premier comprend une phase itérative de conception et de test, en étroite concertation avec les utilisateurs, avec pour but d’explorer des modalités d’interaction humain-robot qui ne s’appuient pas sur l’anthropomorphisme ou le langage verbal. Le deuxième vise à mieux saisir les effets liés à l’insertion du dispositif robotique dans les relations en situation d’usage. Le troisième vise à concevoir des outils et des indicateurs permettant d’évaluer d’un point vue qualitatif et quantitatif l’ensemble de l’expérience.
La personne recrutée sera rattachée à ETIS (UMR 8051, CY Paris Université, ENSEA, CNRS). https://www.etis-lab.fr
Liste des pièces à fournir
Curriculum Vitae, Lettre de motivation.
Date limite de candidature
Le dossier (rassemblé en un seul fichier pdf) devra être envoyé par mail à joffrey.becker[at]ensea.fr avant le 1er juin 2024.
Le poste est à pourvoir pour septembre 2024.
Description du poste
Dans une perspective faisant converger le design, les sciences humaines et sociales, l’informatique, la robotique et les pratiques thérapeutiques, cette thèse vise à mieux saisir les dynamiques sociales et cognitives particulières que les dispositifs dits intelligents font émerger en s'appuyant principalement sur l’enquête ethnographique, les pratiques de conception collaborative et la méthode expérimentale. Elle vise une approche fondée sur les méthodes d'investigation utilisées en robotique dite de terrain. Le projet ambitionne d'apporter une contribution originale à un domaine d'étude qui fait depuis longtemps l'objet de travaux de recherche, que ce soit auprès de personnes travaillant sur les troubles du spectre autistique, en gérontologie, ou dans le cadre d’études sur la médiation.
Le projet vise trois objectifs principaux. Le premier comprend une phase itérative de conception et de test en étroite concertation avec les utilisateurs. Le deuxième vise à mieux saisir les effets liés à l’insertion du dispositif robotique dans les relations en situation d’usage. Le troisième vise à concevoir des outils et des indicateurs permettant d’évaluer d’un point vue qualitatif et quantitatif l’ensemble de l’expérience.
Le premier objectif de la thèse vise à tester les limites de l’anthropomorphisme en robotique dite sociale. À la suite de travaux menés dans le champs des arts et du design sur les objets à comportement et d’autres études interdisciplinaires investiguant l’interaction avec des objets qui n’imitent pas le corps humain ou animal, le premier objectif de la thèse est d'explorer des modalités peu employées de la communication qui ne s'appuient ni sur le langage verbal ni la ressemblance avec le corps humain. Ces deux approches sont considérées comme des facteurs facilitant l'interaction mais certaines études empiriques en ont montré les limites. Le but est ici de tester des modalités de l'interaction plus subtiles, moins codifiées et par conséquent moins sujettes à l'ambiguïté suscitée par l’aspect mécanique des machines anthropomorphes. On peut faire l’hypothèse qu’une telle approche paraisse plus naturelle au yeux de leurs utilisateurs ou du moins qu’elle permette des usages plus souples et des formes de médiation plus simples à mettre en œuvre et à gérer en situation d’usage.
Le deuxième objectif est de tester un tel dispositif en situation d'usage. L'ancrage de ce travail dans le domaine des soins de santé vise à approfondir les connaissances déjà acquises en interaction humain-robot, mais il vise également à construire les outils permettant de mieux prendre en considération les questions sociales plus larges qui caractérisent le contexte thérapeutique. À ce titre, l'expérimentation ne suffit pas. Elle doit également s'appuyer sur une meilleure prise en compte des questions liées aux composantes structurelles, relationnelles, sémantiques, et phénoménologiques inhérentes au contexte thérapeutique, aux configurations sociotechniques, aux reconfigurations humain-machine, aux différentes cultures épistémiques et aux pratiques des soignants, afin de mieux comprendre les implications liées à l'insertion d'objets techniques dits intelligents dans les processus thérapeutiques déjà existants. Dans cette perspective, l’investigation doit s’appuyer sur une démarche ethnographique soucieuse de modéliser les pratiques situées et leur environnement. Attentive aux relations entre soignants, objet et patients, cette démarche a pour but de décrire finement les modalités par lesquelles les humains se saisissent de l’objet et l’utilisent, mais aussi ce qu’il change dans leur relation.
Le troisième objectif est de construire les indicateurs permettant d’évaluer les effets du dispositif sur le plan technique, thérapeutique, social et humain. Cette évaluation est une dimension importante du projet, qui doit s'appuyer sur l'étude des transformations inhérentes à leur introduction dans des configurations déjà existantes et qu'il est donc nécessaire de prendre en compte dans la construction des outils d'évaluation.
Les buts visés par le projet recouvrent plusieurs aspects qui serviront de jalons tout au long du travail de recherche doctorale :
1. Il s’agit de déconstruire très pragmatiquement les pré-conceptions associant la robotique et le domaine du soin (à l’œuvre dans les pratiques de design de robots sociaux à visée thérapeutique) en étant à l’écoute des besoins de celles et ceux qui auront à s’en servir.
2. Il s’agit de reconsidérer l’anthropomorphisme ou le zoomorphisme comme un facteur facilitant l’interaction avec les systèmes dits intelligents en explorant d’autres modalités de la relation à un niveau pré-verbal s’appuyant principalement sur le comportement de l’objet.
3. Il s’agit de rompre avec l'idée que l’emploi des robots a pour issue de remplacer le travail humain, en s’appuyant sur les qualités d’un objet dont la vocation est de constituer un nouvel acteur dans le dispositif de soin.
4. Il s’agit enfin d’évaluer la situation de médiation instaurée par l’objet et les reconfigurations relationnelles qu’elle rend possible.
Le profil idéal
Spécialités du diplôme attendu : robotique, électronique, informatique ou domaines proches.
Niveau d'expérience attendu : Master 2ou diplôme d'ingénieur
Compétences attendues : connaissances attestées dans le domaine de l'informatique, de l'apprentissage machine et de l'électronique.
Savoir-faire : analyse d'articles scientifiques, codage (notamment en python et C), conception de systèmes électroniques, maîtrise de la langue française.
Savoir-être : bricoleur(se), doté(e) d’une bonne capacité d’écoute et d’observation, excellentes compétences en matière de relations interpersonnelles et de collaboration, intérêt pour la recherche interdisciplinaire.