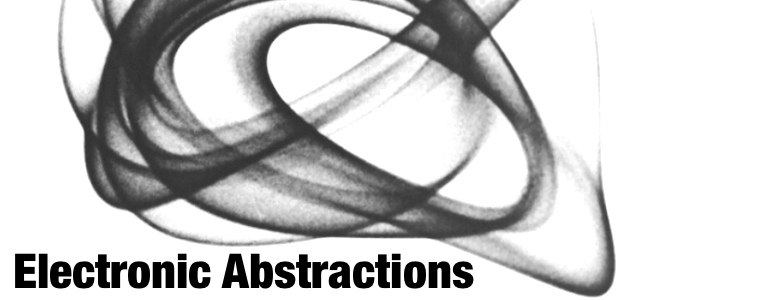dimanche 28 août 2022
Ethnographies of Outer Space
lundi 24 janvier 2022
ROUTINES — a film by Séverine Lagneaux & Joffrey Becker
Routines
a film by Joffrey Becker & Séverine Lagneaux
Filmé en Belgique dans un élevage laitier de la Région wallonne, Routines décrit le quotidien de l’exploitation et les reconfigurations liées à sa robotisation. En adoptant le point de vue des acteurs humains, animaux ou mécaniques, le film explore la façon dont la robotique et l’informatique transforment les interactions et les pratiques domesticatoires.
Filmed in Belgium in a dairying farm in the Walloon region, Routines describes the daily life of the farm and the reconfigurations linked to its robotisation. By adopting the point of view of human, animal or mechanical actors, the film explores the way in which robotics and computer technology transform interactions and domestic practices.
produced by Rien à Voir, CNRS, Fyssen Fund
2022 — documentary — 36 minutes
directors — S. Lagneaux & J. Becker
camera — S. Lagneaux & J. Becker
sound — S. Lagneaux & J. Becker
producer — JF de Hasque
editor — B. Tracq
lundi 27 avril 2020
Ethnographies des Agents Conversationnels , Réseaux n° 220, mai-juin (à paraître)
Coordonné par Marc Relieu & Julia Velkovska
Assistants vocaux, chatbots textuels, robots humanoïdes : la diffusion croissante d’agents conversationnels dans la société fascine, effraye, soulève des questionnements d’ordre philosophique, éthique, juridique, technique, politique et moral. Présents à travers une diversité d’artefacts, ces agencements technologiques sont capables de produire des paroles ou bien des écrits pendant des interactions avec des humains et de simuler des compétences humaines, des rôles sociaux ou encore des formes de relations sociales. Depuis le milieu des années 2000, nous assistons ainsi pour la première fois à des rencontres inédites « grandeur nature » entre des formes de l’intelligence artificielle conversationnelle et des utilisateurs ordinaires dans leur vie quotidienne, en dehors des murs des laboratoires. Les agents conversationnels ont d’abord rejoint les rangs des produits offerts par les plus importants acteurs du numérique : Google, Microsoft, Apple ou Amazon proposent des enceintes connectées pour l’environnement domestique capables d’interagir vocalement avec les utilisateurs. Mais ces agents ne sont que le fer de lance d’un marché plus vaste, qui comprend également les robots conversationnels textuels (chatbots) prenant en charge différentes interactions de service et les robots humanoïdes. Utilisés massivement dans l’assistance technique et commerciale, les chatbots peuvent par exemple accuser réception d’une requête d’un client, repérer le problème posé et rechercher la solution dans des bases de données. Si les services rendus par ces robots conversationnels les rapprochent d’autres applications web, ils s’en distinguent néanmoins par l’utilisation du langage naturel. Enfin, venant s'incarner dans des organismes artificiels matérialisés – les robots humanoïdes – les agents conversationnels se sont enrichis de modalités diverses, par exemple les pointeurs ou les possibilités de mouvement permettant de désigner un objet dans l'environnement ou encore la capacité à détecter la présence de personnes, de reconnaître des émotions et d’exprimer des simulacres émotionnels. Aujourd’hui, les premiers robots d'accueil ou d'assistance fabriqués par cette nouvelle informatique « affective » commencent à passer les limites des laboratoires pour entrer dans les musées ou les situations commerciales. Comment penser les conséquences sociales d’une telle diversité à la fois de formes technologiques et des situations sociales dans lesquelles l’IA conversationnelle vient s’inscrire ? C’est ce défi que le présent dossier de Réseaux se propose de commencer à relever en rassemblant un premier ensemble en français de travaux empiriques sur les interactions avec les agents intelligents. Comment interagit-on avec des agents artificiels ? Quelles relations les personnes développent-elles avec ces machines parlantes ? Quel sens et quelle place ces machines prennent-elles dans notre vie quotidienne ? Comment reconfigurent-elles nos activités à la maison, au travail, dans l’espace public ? Comment nous affectent-elles et quelles formes d’attachement peuvent-elles susciter ?
Les enquêtes réunies dans ce dossier de Réseaux montrent que la recherche en sciences sociales gagne à se saisir empiriquement – avec le regard ajusté aux pratiques propre aux démarches ethnographiques – de la diversité des contextes, des interactions, et des projets auxquels les trois principaux types d’agents conversationnels sont aujourd’hui associés. Pour penser la complexité des infrastructures technologiques associées à ces applications de l’IA et leurs conséquences sur notre vie en société ce numéro propose de s’appuyer sur les résultats d’enquêtes portant à la fois sur la conception, l’appropriation ou les interactions avec ces différents agents. Résolument empirique et descriptif, le parti pris de ce dossier est également pluraliste en accueillant une diversité de manières de faire des ethnographies de l’IA. Réunissant des travaux ancrés dans l’ethnométhodologie, l’analyse conversationnelle, la vidéo-ethnographie, la linguistique interactionnelle, la sociologie économique ou l’anthropologie sociale il témoigne de la fécondité des approches observationnelles pour prendre la mesure des transformations technologiques et sociales contemporaines à l’échelle des pratiques.
Les contributions :
« Pourquoi ethnographier les agents conversationnels ? »
– Par Marc Relieu et Julia Velkovska
« Tisser des liens : l’interaction sociale chez les agents conversationnels »
– Par Justine Cassell
« Les relations aux machines ‘conversationnelles’ : Vivre avec les assistants vocaux à la maison »
– Par Julia Velkovska et Moustafa Zouinar
« Une approche configurationnelle des leurres conversationnels »
– Par Marc Relieu, Merve Sahin et Aurélien Francillon
« Répondre aux questions d’un robot : dynamique de participation des groupes adultes-enfants dans les rencontres avec un robot-guide du musée »
– Par Karola Pitsch
« ‘Je dois y aller’. Analyses de séquences de clôtures entre humains et robots »
– Par Christian Licoppe et Nicolas Rollet
« Construire la ‘compréhension’ d’une machine : une ethnographie de conception de deux chatbots commerciaux »
– Par Charlotte Esteban
« Concevoir des machines anthropomorphes. Ethnographie des pratiques de conception »
– Par Joffrey Becker
lundi 5 novembre 2018
Biosphere 2 - Feb 2018
Short-film made by Joffrey Becker, in collaboration with Perig Pitrou & Istvan Praet thanks to the support of PSL Research University program IRIS-OCAV/Bioarti and CNRS-UA UMI IGlobes.