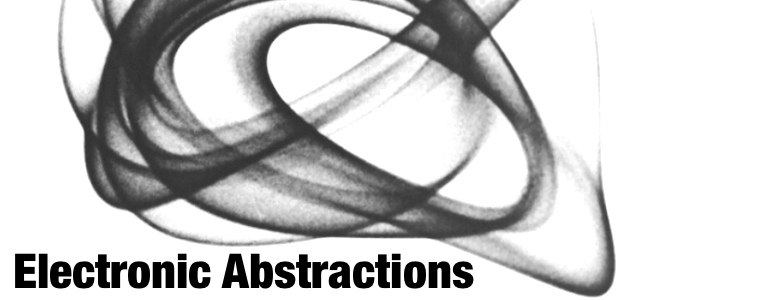- La thématique de la soumission (Conception de l'objet, Expérimentation et observation, Analyse)
- La discipline de l'auteur
- Le type de soumission (Présentation & table ronde, Atelier, Démonstration, Installation, Poster)
mardi 9 juillet 2024
[AAC] Drôles d'Objets 2025
vendredi 15 mars 2024
[École thématique] Expérimenter l'interaction humain-objet : théories, méthodologies, analyses
Expérimenter l'interaction humain-objet : théories, méthodologies, analyses
École thématique [XIHO24]
28-31 oct. 2024 Bordeaux (France)
https://xiho24.sciencesconf.org
XIHO24 est une école thématique sur la robotique sociale organisée par le groupe pluridisciplinaire de recherche Psyphine. Pendant quatre jours, l’école combinera des cours avancés et des ateliers pratiques destinés à former des chercheurs·euses de toutes disciplines au domaine de l’interaction humain-robot. Le principal objectif de cet événement est d'élaborer un protocole expérimental, permettant une analyse approfondie des interactions entre individus et objets robotisés, qu'ils soient anthropomorphes ou non. En s’appuyant sur différentes plateformes robotiques, les participants pourront explorer les dynamiques de la robotique sociale, tout en étendant leurs compétences en matière de conception d’expérimentation et de recherche interdisciplinaire.
Cette école est ouverte aux étudiants de masters 2, aux doctorant·e·s comme aux enseignant·e·s-chercheur·se·s.
Modalités de candidature
L'école XIHO24 se déroulera à Bordeaux du 28 au 31 octobre inclus, la présence est impérative pendant les 4 jours.
Pour vérifier que cette école est en adéquation avec vos besoins, nous vous demandons de nous adresser dans un seul fichier pdf votre CV (de 1 à 3 pages) et une lettre de motivation que vous pouvez déposer sur le site https://xiho24.sciencesconf.org, en cliquant sur le bouton "Déposer votre dossier". Il faut créer un compte sur SciencesConf si vous n'en avez pas déjà un.
Tarifs
Étudiant·es en Master : 20 €
Doctorant·es et post-doctorant·es : 50 €
Enseignant·es/chercheur·ses : 100 €
L'inscription comprend les déjeuners, les pauses café et un diner.
Nous délivrerons des attestations de participation à l'école thématique.
lundi 11 décembre 2023
Soft control: behavioral matter & the art of replicability / .able
Soft control: behavioral matter & the art of replicability
Ana Piñeyro & Joffrey Becker - November 09, 2023
Intertwining the work of designer Ana Piñeyro and anthropologist Joffrey Becker, this video essay presents an archeology of the processes involved in the transformation of matter and the manifestation of its behavior. It addresses the epistemological question of the reproducibility of results.
.able is an image-based multi-platform journal at the intersection of art, design, and sciences, responding to the complexities of contemporary society and environmental concerns.
Find the article on .able: https://able-journal.org/en/soft-control/
Credits
Authors: Ana Piñeyro and Joffrey Becker
Visual designer: Ana Piñeyro
Sound designer: Joffrey Becker
Editorial mediation: Joffrey Becker
Dialogue recording: Christian Phaure, École des Arts Décoratifs
Financial support: La Chaire Beauté·s PSL – L’Oréal
Acknowledgments: Gwenaëlle Lallemand; Samuel Bianchini; La Chaire arts et sciences, of the École polytechnique de l’École des Arts Décoratifs – Université PSL and the Fondation Daniel et Nina Carasso.
lundi 18 juillet 2022
[AAC] Droles d'objets 2023
- La thématique de la soumission (Conception de l'objet, Expérimentation et observation, Analyse)
- La discipline de l'auteur
- Le type de soumission (Présentation & table ronde, Atelier, Démonstration, Installation, Poster)
- 31 octobre 2022 : Date limite de soumission
- Février 2023 : Notification aux auteurs
mardi 12 avril 2022
c:o/re Workshop: Interdisciplinary Research in Robotics and AI
lundi 27 septembre 2021
Conférence Drôles d'Objets - Un nouvel art de faire / La Rochelle 27-29 oct. 2021
Inscriptions en ligne sur le site : https://drolesdobjets20.sciencesconf.org
mardi 25 mai 2021
ICRA 2021 - Sentimental Machines
Our paper "Picking Up Good Vibrations: Designing an Experimental Setup to Assess the Role of Vibrations in Human-Robot Interaction" will be presented at the IEEE International Conference on Robotics and Automation on June 4, 2021 – 10:00AM CET.
*
Joffrey Becker, Samuel Bianchini, Hugo Scurto, Elena Tosi Brandi, "Picking Up Good Vibrations: Designing an Experimental Setup to Assess the Role of Vibrations in Human-Robot Interaction", IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation, ICRA’21, Sentimental Machines, Xi’an, 2021
Abstract: Focusing on behavioral objects (considered as art and design objects which are not figurative nor utilitarian), this article describes a first step in the design of a research and creation project called The Appprentices. Conceived as an environment containing three behavioral objects which movements are amplified, The Appprentices constitutes an experimental platform which aims to contribute to a better understanding of the modalities by which humans and objects are in a situation of nonverbal communication. The project aims to contribute to the study of animism in human-robot interaction (HRI) but also to the study of analogical forms of communication generally prevailing in multi-species interaction. It therefore implies to pay a particular attention to the design of a shared space. Reviewing several works in the field of art and design where vibration plays a central role, we address a dimension of animism that is still poorly studied in HRI anthropology, based not on the idea that objects are considered as persons but rather that their collective activities can be considered by analogy with social life. We then identify vibration as a relevant modality for relating human and nonhuman collectives, which allows a frame for interaction within which vibratory signals can be exchanged and embodied. The article concludes with a description of the architecture of the shared vibratory space designed for the project.
Conference website: https://roboticart.org/icra2021
Registration (free): https://www.eventbrite.co.uk/e/sentimental-machines-workshp-during-icra21-conference-tickets-155505116991
jeudi 4 juin 2020
Concevoir des machines anthropomorphes
Becker Joffrey, « Concevoir des machines anthropomorphes. Ethnographie des pratiques de conception en robotique sociale », Réseaux, 2020/2 (N° 220-221), p. 223-251
Résumé : À partir de deux cas extraits de l’ethnographie, cet article propose d’étudier comment s’articulent les approches théoriques et les techniques mobilisées en robotique pour concevoir des interfaces relationnelles. En revenant sur l’intérêt des roboticiens pour la biologie et le théâtre, l’article questionne la façon dont ces derniers s’y prennent pour tenter de faciliter les relations que nous pouvons avoir avec leurs objets. Il porte plus particulièrement l’attention sur les opérations de transfert par lesquelles les chercheurs en robotique intègrent des comportements à leurs robots afin d’apporter un point de vue complémentaire au champ de l’anthropologie des interactions humain-machine, qui prenne en compte les pratiques de conception.
Becker Joffrey, « Designing anthropomorphic machines : An ethnography of design practices », Réseaux, 2020/2 (N° 220-221), p. 223-251
URL : https://www.cairn.info/revue-reseaux-2020-2-page-223.htm
lundi 27 avril 2020
Ethnographies des Agents Conversationnels , Réseaux n° 220, mai-juin (à paraître)
Coordonné par Marc Relieu & Julia Velkovska
Assistants vocaux, chatbots textuels, robots humanoïdes : la diffusion croissante d’agents conversationnels dans la société fascine, effraye, soulève des questionnements d’ordre philosophique, éthique, juridique, technique, politique et moral. Présents à travers une diversité d’artefacts, ces agencements technologiques sont capables de produire des paroles ou bien des écrits pendant des interactions avec des humains et de simuler des compétences humaines, des rôles sociaux ou encore des formes de relations sociales. Depuis le milieu des années 2000, nous assistons ainsi pour la première fois à des rencontres inédites « grandeur nature » entre des formes de l’intelligence artificielle conversationnelle et des utilisateurs ordinaires dans leur vie quotidienne, en dehors des murs des laboratoires. Les agents conversationnels ont d’abord rejoint les rangs des produits offerts par les plus importants acteurs du numérique : Google, Microsoft, Apple ou Amazon proposent des enceintes connectées pour l’environnement domestique capables d’interagir vocalement avec les utilisateurs. Mais ces agents ne sont que le fer de lance d’un marché plus vaste, qui comprend également les robots conversationnels textuels (chatbots) prenant en charge différentes interactions de service et les robots humanoïdes. Utilisés massivement dans l’assistance technique et commerciale, les chatbots peuvent par exemple accuser réception d’une requête d’un client, repérer le problème posé et rechercher la solution dans des bases de données. Si les services rendus par ces robots conversationnels les rapprochent d’autres applications web, ils s’en distinguent néanmoins par l’utilisation du langage naturel. Enfin, venant s'incarner dans des organismes artificiels matérialisés – les robots humanoïdes – les agents conversationnels se sont enrichis de modalités diverses, par exemple les pointeurs ou les possibilités de mouvement permettant de désigner un objet dans l'environnement ou encore la capacité à détecter la présence de personnes, de reconnaître des émotions et d’exprimer des simulacres émotionnels. Aujourd’hui, les premiers robots d'accueil ou d'assistance fabriqués par cette nouvelle informatique « affective » commencent à passer les limites des laboratoires pour entrer dans les musées ou les situations commerciales. Comment penser les conséquences sociales d’une telle diversité à la fois de formes technologiques et des situations sociales dans lesquelles l’IA conversationnelle vient s’inscrire ? C’est ce défi que le présent dossier de Réseaux se propose de commencer à relever en rassemblant un premier ensemble en français de travaux empiriques sur les interactions avec les agents intelligents. Comment interagit-on avec des agents artificiels ? Quelles relations les personnes développent-elles avec ces machines parlantes ? Quel sens et quelle place ces machines prennent-elles dans notre vie quotidienne ? Comment reconfigurent-elles nos activités à la maison, au travail, dans l’espace public ? Comment nous affectent-elles et quelles formes d’attachement peuvent-elles susciter ?
Les enquêtes réunies dans ce dossier de Réseaux montrent que la recherche en sciences sociales gagne à se saisir empiriquement – avec le regard ajusté aux pratiques propre aux démarches ethnographiques – de la diversité des contextes, des interactions, et des projets auxquels les trois principaux types d’agents conversationnels sont aujourd’hui associés. Pour penser la complexité des infrastructures technologiques associées à ces applications de l’IA et leurs conséquences sur notre vie en société ce numéro propose de s’appuyer sur les résultats d’enquêtes portant à la fois sur la conception, l’appropriation ou les interactions avec ces différents agents. Résolument empirique et descriptif, le parti pris de ce dossier est également pluraliste en accueillant une diversité de manières de faire des ethnographies de l’IA. Réunissant des travaux ancrés dans l’ethnométhodologie, l’analyse conversationnelle, la vidéo-ethnographie, la linguistique interactionnelle, la sociologie économique ou l’anthropologie sociale il témoigne de la fécondité des approches observationnelles pour prendre la mesure des transformations technologiques et sociales contemporaines à l’échelle des pratiques.
Les contributions :
« Pourquoi ethnographier les agents conversationnels ? »
– Par Marc Relieu et Julia Velkovska
« Tisser des liens : l’interaction sociale chez les agents conversationnels »
– Par Justine Cassell
« Les relations aux machines ‘conversationnelles’ : Vivre avec les assistants vocaux à la maison »
– Par Julia Velkovska et Moustafa Zouinar
« Une approche configurationnelle des leurres conversationnels »
– Par Marc Relieu, Merve Sahin et Aurélien Francillon
« Répondre aux questions d’un robot : dynamique de participation des groupes adultes-enfants dans les rencontres avec un robot-guide du musée »
– Par Karola Pitsch
« ‘Je dois y aller’. Analyses de séquences de clôtures entre humains et robots »
– Par Christian Licoppe et Nicolas Rollet
« Construire la ‘compréhension’ d’une machine : une ethnographie de conception de deux chatbots commerciaux »
– Par Charlotte Esteban
« Concevoir des machines anthropomorphes. Ethnographie des pratiques de conception »
– Par Joffrey Becker
dimanche 31 janvier 2016
Predictive Studio 24H
9h40 Anolga Rodionoff, Les territoires saisis par le virtuel
10h20 Etienne Armand Amato, L'immersion dans l'image interactive : un art de vivre
11H00 Joffrey Becker, La société-machine à l'heure de la robotique avancée
11h40 Yann Minh, Le Nøømuseum
14h00 Lancement du workshop par Armand Behar et Anne Dubos
Présentation publique des travaux (sur inscription)
Vendredi 5 février 16h00 à l'ENSCI