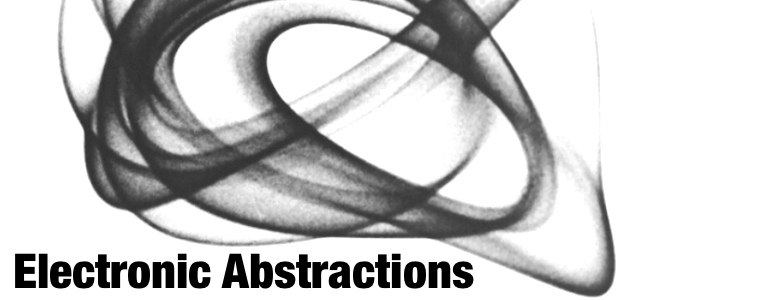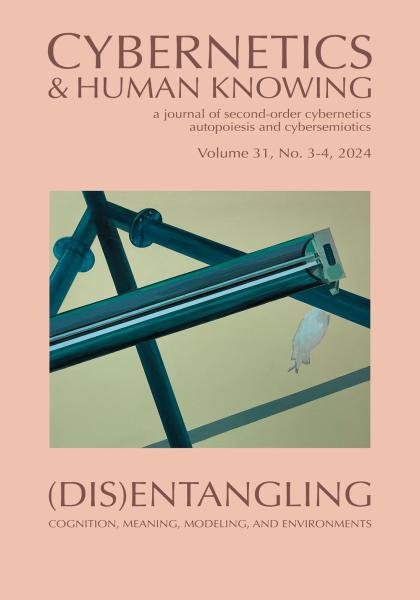Offre d'emploi
Ingénieur.e de recherche en robotique
Médiations Robotiques en Soins de Santé (MR2S)
À propos
Fondée en 1952, l’ENSEA est une école publique d’excellence qui forme des ingénieurs généralistes, reconnus dans le monde industriel et à l’international. Située aux portes de Paris, l’école s’est bâtie sur 3 piliers fondamentaux expertise, inclusivité et durabilité, qui sont au cœur de ses activités de recherche, d’innovation et d’enseignement.
Présentation du projet
Dans une perspective interdisciplinaire, le projet MR2S vise à mieux saisir les dynamiques sociales et cognitives particulières que les dispositifs dits intelligents font émerger en s'appuyant principalement sur les pratiques de conception collaborative et la méthode expérimentale. Son but est de concevoir, de tester et d’évaluer l’inscription d’un robot dans le processus de médiation thérapeutique en partenariat avec un centre de soin pour enfants souffrant de troubles du spectre de l’autisme (TSA).
La personne recrutée sera rattachée au laboratoire ETIS (UMR 8051, CY Paris Université, ENSEA, CNRS / https://www.etis-lab.fr/) et travaillera en étroite collaboration avec la doctorante déjà recrutée dans le cadre du projet MR2S.
Liste des pièces à fournir
Curriculum Vitae, Lettre de motivation.
Date limite de candidature
Le dossier (rassemblé en un seul fichier pdf) devra être envoyé à joffrey.becker[at]ensea.fr avant le 1er juin 2025.
Le poste est à pourvoir pour octobre 2025.
Description du poste
Durée : 11 mois
Catégorie : Recherche
Type : CDD
Contact : joffrey.becker[at]ensea.fr
La robotique sociale à visée thérapeutique s’appuie principalement sur des dispositifs techniques à forme humaine ou animale. Le projet vise à tester le potentiel thérapeutique d’une machine à vocation sociale sans recourir à l’esthétique anthropomorphique ou zoomorphique. Pour ce faire, le projet MR2S vise la conception d’un robot souple basé sur le principe de tenségrité et intégrant notamment un capteur de type Swept Frequency Capacitive Sensing.
Le poste offert s’articule autour de deux grands ensembles de tâches :
- À partir des travaux menés par un stagiaire mécatronicien recruté pour 6 mois en 2025, il s’agira d’une part de concevoir l’ensemble du dispositif robotique (mécatronique et programmation). Nous mettons à disposition de la personne recrutée l’ensemble de la documentation technique issue des travaux menés lors de ce stage. L’objectif est la mise en œuvre d’un prototype complètement opérationnel.
- D’autre part, il s’agira de mettre en œuvre et d’accompagner les tests et les expériences prévus dans le cadre du projet MR2S dans la première partie de l’année 2026. Conduites dans le cadre de la thèse associée au projet, ces expériences en interaction humain-robot constituent une étape clé. Les travaux menés par la personne recrutée seront valorisés par la publication des résultats obtenus pendant ces deux phases.
Le profil idéal
Spécialités du diplôme attendu : Robotique, électronique, informatique.
Niveau d'expérience attendu : Master 2 ou Diplôme d’ingénieur
Compétences attendues : Connaissances attestées dans le domaine de l’électronique et de l'informatique.
Savoir-faire : Conception de systèmes électroniques, codage (notamment en python et C), maîtrise de l’impression 3D, maîtrise de la langue française.
Savoir-être : Bricoleur.se, doté.e d’excellentes compétences en matière de relations interpersonnelles et de collaboration, intérêt pour la recherche interdisciplinaire.