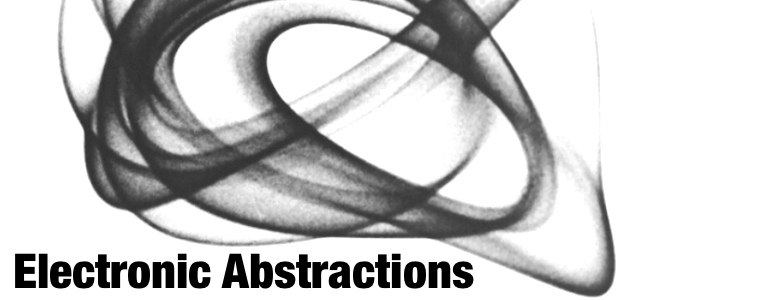Le texte dont est issu cet article est consultable à l'adresse suivante :
http://www.joffreybecker.fr/pdf/JBecker_LesForcesDeLAttraction.pdf
Lorsqu'on songe aux représentations artistiques de la présence humaine dans l'espace les « vues d'artistes » viennent immédiatement à l'esprit. Les arts de la performance entretiennent eux aussi des liens étroits avec le domaine de l'exploration spatiale, partageant avec ce dernier un souci commun pour la vie humaine dans ce qu'elle a de plus banal et cherchant, par le biais de techniques spécifiques, à déplacer les conditions caractérisant l'existence terrestre dans un environnement étranger.
Émergeant progressivement au milieu des année 1960, l’intérêt de Trisha Brown pour la gravité nait avec Planes, en 1968, et il est intimement lié au contexte de conquête de l’espace. Avec le voyage spatial, il apparaît désormais que la gravité est un élément conditionnant la vie sur Terre. Cet intérêt va donner naissance à plusieurs travaux chorégraphiques entre 1968 et 1971, les Equipment Dances. Dans ces pièces, un mouvement simple de marche est mis en tension par des structures architecturales spécifiques, comme des murs ou des objets.
Il est difficile de savoir dans quelle mesure Trisha Brown a eu connaissance des travaux menés au Langley Research Center dans les années 1960. Les installations de la base aérienne ont fait l’objet d’un reportage télévisé en 1968, durant lequel le présentateur et journaliste de CBS Walter Cronkite s’est essayé au simulateur de gravité lunaire installé pour entrainer les astronautes. Susan Rosenberg note par ailleurs que le travail de Trisha Brown a suscité l’intérêt du directeur de la revue Astronautics & Aeronautics qui, dans une lettre écrite en 1976, l’enjoint à visiter les installations de la base aérienne. Il est en fait de peu d’importance de chercher à déterminer comment l’artiste américaine a eu l’idée de Walking on the wall.
Le contexte des années 1960 est traversé d’un engouement populaire sans précédent pour la représentation du corps humain dans l’espace. Le travail sur le rôle de la gravité dans la danse mené par Trisha Brown s’inscrit dans les questions scientifiques et techniques posées en son temps. Et ces questions traversent bien plus largement le champ des arts, où elles prennent parfois la forme d’étranges machines, mixte de tâches humaines et d’équipement technique.
La simulation de la gravité lunaire menée par la division de mécanique spatiale du centre de recherche de Langley présente des ressemblances évidentes avec le travail de la chorégraphe américaine. Cette recherche ambitionne de comprendre comment des gestes aussi ordinaires que marcher, sauter, courir, monter et descendre une échelle peuvent être accomplis lorsqu’ils sont réalisés dans des conditions de gravité ne représentant qu’un-sixième de la gravité terrestre. Ces expérimentations ressortent d’un même logique de programmation de l’activité corporelle et d’un même souci pour le déplacement des activités ordinaires dans une architecture transformée.
Le déplacement de la banalité a ainsi un prix, qui est celui de la technique. Pour que le corps humain agisse au-delà des frontières terrestres, il lui faut être équipé, augmenté, et même « refait pour vivre dans l’espace », ainsi que le suggère un article paru dans Life Magazine le 11 juillet 1960, consacré aux travaux du psychiatre Nathan Kline et de l’informaticien Manfred Clynes, les pères de la notion de cyborg. Ce terme est né de la volonté de libérer l'humain des contraintes d'un environnement spatial bien trop complexe pour lui, sans pour autant remettre en question ses capacité intellectuelles, sa créativité, et son goût de l'exploration.
La notion décrit un corps étendu, s'appuyant sur des dispositifs techniques grâce auxquels il lui est possible d'agir. C'est en somme le corps que nous avons toujours eu. Ce corps qui a toujours été appareillé, toujours équipé de crayons, d'ordinateurs, ou d'institutions, de tous ces « outils » qui nous permettent d’échafauder et de transformer nos idées. Ce corps qui, « partout, sous des formes diverses mais toujours à quelques degrés, […] est l'objet de modifications ou d'adjonctions. » comme l'ont souligné Michel Leiris et Jacqueline Delange.
Or ce corps équipé, qui traverse le travail de Trisha Brown comme celui des ingénieurs du Langley Research Center, va bien au-delà des extensions matérielles décrites par la notion de cyborg. Pour en saisir la profondeur, il faut comprendre ce corps comme la combinaison subtile de l’activité des collectifs humains et des machines. Système socio-technique, plastique, en contradiction parfois avec lui-même, ou résistant à ses propres prérogatives, les agencements humains et matériels caractérisant la performance des danseurs et des astronautes forment la condition par laquelle il est possible de susciter l’imagination en variant les paramètres des conditions ordinaires d’existence.
Pour aller plus loin :
Rosenberg Susan, 2017, Trisha Brown, Choreography as Visual Art, Middletown, Wesleyan University Press
Reduced Gravity Simulator for Study of Man's Self Locomotion, NASA Langley CRGIS (Film)
http://www.joffreybecker.fr/pdf/JBecker_LesForcesDeLAttraction.pdf
Lorsqu'on songe aux représentations artistiques de la présence humaine dans l'espace les « vues d'artistes » viennent immédiatement à l'esprit. Les arts de la performance entretiennent eux aussi des liens étroits avec le domaine de l'exploration spatiale, partageant avec ce dernier un souci commun pour la vie humaine dans ce qu'elle a de plus banal et cherchant, par le biais de techniques spécifiques, à déplacer les conditions caractérisant l'existence terrestre dans un environnement étranger.
Émergeant progressivement au milieu des année 1960, l’intérêt de Trisha Brown pour la gravité nait avec Planes, en 1968, et il est intimement lié au contexte de conquête de l’espace. Avec le voyage spatial, il apparaît désormais que la gravité est un élément conditionnant la vie sur Terre. Cet intérêt va donner naissance à plusieurs travaux chorégraphiques entre 1968 et 1971, les Equipment Dances. Dans ces pièces, un mouvement simple de marche est mis en tension par des structures architecturales spécifiques, comme des murs ou des objets.
« J’ai été associée à la construction d’accessoires gigantesques et à des systèmes techniques permettant à des êtres humains de marcher sur des murs, de descendre la façade d’un immeuble de sept étages, d’apparaitre en chute libre ou suspendus dans un espace neutre – des travaux au centre desquels les préoccupations principales sont l’anti-gravité et le mouvement ordinaire tel qu’il apparaît dans des circonstances extraordinaires. » (Trisha Brown, 1973, « Group Primary Accumulation »)Avec Walking on the wall, Trisha Brown ne décontextualise pas seulement une action en la verticalisant, brouillant par conséquent les repères spatiaux ordinaires des spectateurs. La performance comporte aussi une dimension phénoménologique qui déplace l’expérience même des danseurs en les obligeant d’une certaine manière à réapprendre à marcher. Marcher sur un mur en étant soutenu par des fils eux-mêmes accrochés à un rail n’est, on peut s’en douter, pas chose banale. Et c’est tout l’enjeu de l’expérimentation que de donner à voir ce déplacement au public.
 |
| Steve Paxton, Trisha Brown, Walking on the Wall, Whitney Museum of American Art, NY. Photo - Carol Goodden 1971 |
Il est difficile de savoir dans quelle mesure Trisha Brown a eu connaissance des travaux menés au Langley Research Center dans les années 1960. Les installations de la base aérienne ont fait l’objet d’un reportage télévisé en 1968, durant lequel le présentateur et journaliste de CBS Walter Cronkite s’est essayé au simulateur de gravité lunaire installé pour entrainer les astronautes. Susan Rosenberg note par ailleurs que le travail de Trisha Brown a suscité l’intérêt du directeur de la revue Astronautics & Aeronautics qui, dans une lettre écrite en 1976, l’enjoint à visiter les installations de la base aérienne. Il est en fait de peu d’importance de chercher à déterminer comment l’artiste américaine a eu l’idée de Walking on the wall.
Le contexte des années 1960 est traversé d’un engouement populaire sans précédent pour la représentation du corps humain dans l’espace. Le travail sur le rôle de la gravité dans la danse mené par Trisha Brown s’inscrit dans les questions scientifiques et techniques posées en son temps. Et ces questions traversent bien plus largement le champ des arts, où elles prennent parfois la forme d’étranges machines, mixte de tâches humaines et d’équipement technique.
La simulation de la gravité lunaire menée par la division de mécanique spatiale du centre de recherche de Langley présente des ressemblances évidentes avec le travail de la chorégraphe américaine. Cette recherche ambitionne de comprendre comment des gestes aussi ordinaires que marcher, sauter, courir, monter et descendre une échelle peuvent être accomplis lorsqu’ils sont réalisés dans des conditions de gravité ne représentant qu’un-sixième de la gravité terrestre. Ces expérimentations ressortent d’un même logique de programmation de l’activité corporelle et d’un même souci pour le déplacement des activités ordinaires dans une architecture transformée.
 |
| Un astronaute au Langley Research Center (NASA courtesy photo/Released) |
Le déplacement de la banalité a ainsi un prix, qui est celui de la technique. Pour que le corps humain agisse au-delà des frontières terrestres, il lui faut être équipé, augmenté, et même « refait pour vivre dans l’espace », ainsi que le suggère un article paru dans Life Magazine le 11 juillet 1960, consacré aux travaux du psychiatre Nathan Kline et de l’informaticien Manfred Clynes, les pères de la notion de cyborg. Ce terme est né de la volonté de libérer l'humain des contraintes d'un environnement spatial bien trop complexe pour lui, sans pour autant remettre en question ses capacité intellectuelles, sa créativité, et son goût de l'exploration.
La notion décrit un corps étendu, s'appuyant sur des dispositifs techniques grâce auxquels il lui est possible d'agir. C'est en somme le corps que nous avons toujours eu. Ce corps qui a toujours été appareillé, toujours équipé de crayons, d'ordinateurs, ou d'institutions, de tous ces « outils » qui nous permettent d’échafauder et de transformer nos idées. Ce corps qui, « partout, sous des formes diverses mais toujours à quelques degrés, […] est l'objet de modifications ou d'adjonctions. » comme l'ont souligné Michel Leiris et Jacqueline Delange.
Or ce corps équipé, qui traverse le travail de Trisha Brown comme celui des ingénieurs du Langley Research Center, va bien au-delà des extensions matérielles décrites par la notion de cyborg. Pour en saisir la profondeur, il faut comprendre ce corps comme la combinaison subtile de l’activité des collectifs humains et des machines. Système socio-technique, plastique, en contradiction parfois avec lui-même, ou résistant à ses propres prérogatives, les agencements humains et matériels caractérisant la performance des danseurs et des astronautes forment la condition par laquelle il est possible de susciter l’imagination en variant les paramètres des conditions ordinaires d’existence.
Pour aller plus loin :
Rosenberg Susan, 2017, Trisha Brown, Choreography as Visual Art, Middletown, Wesleyan University Press
Reduced Gravity Simulator for Study of Man's Self Locomotion, NASA Langley CRGIS (Film)